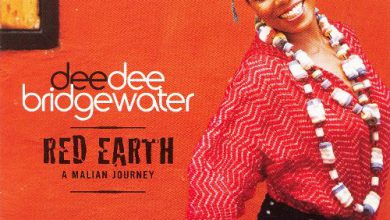Jean-Maurice Noah : le théoricien infatigable des musiques du Cameroun

Rappelons tout d’abord ces quelques antécédents. Au tout début des années 90, sortant d’une expérience bien fructueuse avec les musiciens originaires d’Afrique du sud, le musicien américain Paul Simon recrute dans son écurie un certain Vincent Nguini et lui confie la direction de son orchestre. Lorsque sort le premier album de cette collaboration, Rythm of the saints, le monde entier est spécialement marqué par un titre : ‘Proof’. Un bikutsi savamment cuisiné par Nguini, avec la contribution d’autres talents camerounais comme Armand et Sabbal Lecco, Martin Atangana, Georges Seba, Sissy Dipoko, Charlotte Mbango… Presqu’au même moment, un autre patron du jazz, Jean-Luc Ponty, prend attache avec un autre Camerounais, Brice Wassy, percussionniste de renom et ancien membre de l’écurie Manu Dibango. L’idée est de fabriquer un album à la sauce africaine. Lorsque l’album sort dans les bacs, trois titres, en plus du titre phare Tchokola concocté par Wassy, sont camerounais : ‘Mouna Bowa’’, bel exemple de makossa, composé par Guy Nsanguè Akwa ; ‘Nfan mot’’ un bikutsi de bon cru, sorti du fin fond de la forêt mais châtié par une rythmique et une orchestration universelles ; et ‘Bottle drop’’, un assiko rythmé aux couleurs du violon de Ponty. Parmi les musiciens invités pour cette «aventure», l’on retrouve naturellement Brice Wassy, mais aussi Guy Nsanguè, Yves Ndjock, Martin Atangana, et Willy N’for.
Ces quelques faits, triés sur le volet, indiquent à suffisance, le niveau de maturation et de consécration auxquels les rythmes camerounais étaient parvenus. Un seuil bien respectable, mais contrasté en ces années 90 par une perte d’intérêt de la part de la critique musicale. Il faudrait toutefois, signaler le travail de pionnier effectué par David Ndachi Tagne (Anne Marie Nzié : secrets d’or, Sopecam, 1990 et Francis Bebey, L’Hrmattan, 1993), ainsi que Trois kilos de café, livre-interview sur Manu Dibango écrit par une journaliste française. Et ajouter à cela quelques évocations (Wolfgang Bender, La musique africaine contemporaine, L’Harmattan, 1992 ; Nago Seck et Sylvie Clerfeuille, Les musiciens du beat africain, Brodas, 1993). En dehors de cela, les rythmes camerounais, bien que créatifs et dynamiques, souffrent d’un déficit de théorisation. C’est sur ce terrain que Jean-Maurice Noah va se consacrer, se donnant pour objectif, non moins prométhéen, de décrire ces musiques, par une approche à la fois diachronique et synchronique.
Le bikutsi et le makossa au laser
En quelques 128 pages, l’auteur promène le lecteur dans les arcanes bien complexes d’une constellation de musiques de la forêt. Parmi celles-ci, l’on note, entre autres, l’élak, l’ékang, le mengan, le mbali, l’ésani, le koué, l’ozila etc., autant de socles à partir desquels des combinaisons orchestrales et rythmiques ont enfanté d’autres sonorités pour la plupart hybrides, regroupées sous un vocable fédérateur : le bikutsi.
Ce professeur de philosophie né à Yaoundé en 1968 se fait remarquer lorsqu’il publie (l’ouvrage n’est pas daté, mais certaines sources indiquent 2001) Le Bikutsi du Cameroun : ethnomusicologie des seigneurs de la forêt (Yaoundé, Ed. Carrefour/ERICA). La préface est de René Martin Atangana, guitariste, enseignant-chercheur aux États-Unis mais surtout un des ténors de légion diasporique de la musique camerounaise, dont les hauts faits ont été indiqués plus haut. L’ouvrage se termine par une postface du Père Alcide Baggio de la Fondation Don Bosco. En quelques 128 pages, l’auteur promène le lecteur dans les arcanes bien complexes d’une constellation de musiques de la forêt. Parmi celles-ci, l’on note, entre autres, l’élak, l’ékang, le mengan, le mbali, l’ésani, le koué, l’ozila etc., autant de socles à partir desquels des combinaisons orchestrales et rythmiques ont enfanté d’autres sonorités pour la plupart hybrides, regroupées sous un vocable fédérateur : le bikutsi. Dans cet opus, Jean-Maurice Noah livre une sorte de phénoménologie du bikutsi, relevant notamment les grands acteurs ayant véritablement usé qui d’un coup de génie, qui d’un sens aigu d’opportunisme pour aider ce rythme à sortir du maquis pour s’installer dans la cité : Claude Tchemeni, Jean-Marie Ahanda, Foty et Lanceleaux, Mystic Djim, Douglas Mbida, Justin Bowen, Albert Broeuk’s, Georges Seba, etc.
Après le bikutsi, Noah publiera neuf ans plus tard un autre opus (Le Makossa. Une musique africaine moderne, L’Harmattan, 2010). En effet, le makossa est cet autre rythme issu du littoral camerounais qui a flamboyé les scènes africaines et mondiales, avec plus de 5000 standards enregistrés, mobilisant des musiciens du Cameroun, mais également de la France métropolitaine et ultramarine, du Zaïre, du Congo, du Bénin, de la Côte d’Ivoire, de l’Arménie et même de la Scandinavie. Une sonorité qui doit son succès à son option ouvertement hybride, marquée par une fusion avec les rythmes locaux (mangambeu, bikutsi, assiko…) et internationaux (soul, salsa, disco, zouk, jazz, soukouss…) Le livre est préfacé par le politiste Mathias-Eric Owona Nguini, enseignant à l’Université de Yaoundé II, qui, du reste, s’était déjà signalé en publiant en 1995 un article désormais célèbre : «La controverse bikutsi-Makossa : musique, politique et affinités régionales au Cameroun (1990-1994)» (Afrique Politique, Centre d’Etudes d’Afrique Noire). Bien que présentant des lacunes au plan éditorial (cf. Mosaïques n°008, juillet 2011), l’ouvrage a l’avantage de faire le point sur l’évolution du Makossa, en mettant un accent sur les innovations esthétiques et chorégraphiques qui ont jalonné son histoire.
Comment écrire l’ADN des musiques du Cameroun ?
Le travail de Noah fait suite à une timide tradition de critique musicale, au départ largement tributaire du monde académique. On peut citer, entre autres : Stanislas Owona, Danses du Cameroun (Ministère de l’Education, de la culture et de la formation professionnelle, Yaoundé, 1971.) ; Daniel Anicet Noah, «La musique camerounaise : l’expansion» (Yaoundé-ESIJY, octobre 1976.) et Rémy Ninko Mba, «Le Phénomène Makossa (Yaoundé-ESIJY, 1977). Il convient d’ajouter à cette liste, l’article «La controverse bikutsi-Makossa : musique, politique et affinités régionales au Cameroun» (1990-1994)» d’Owona Nguini, ainsi que le petit essai incisif d’Hubert Mono Ndjana, Les chansons de Sodome et Gomorrhe (Carrefour, Yaoundé, 2000). Ces travaux ont consisté, pour les premiers, à décrire les différents rythmes, en insistant pour certains sur leurs différents socles culturels. A cette approche ethnogénétique, les autres études (notamment celles menées par Minko Mba, Anicet Noah et Owona Nguini) ont associé l’approche sociologique, permettant de ressortir non seulement toute la socioculture générée par ces musiques, mais également les différents exploitations et fructifications aux plans politique, économique et identitaire.
L’apport de Noah dans cette tentative de théorisation des musiques camerounaises est d’avoir ajouté une observation holistique de ces phénomènes musicaux, en se risquant quelques fois à leur systématique. Il fait remarquer en effet une liaison ontologique entre la musique et la danse, qu’il s’agisse du bikutsi ou du makossa. Il nous apprend que le bikutsi est «sur le plan sémantique, en liaison étroite avec le point de vue morphologique, «Bikutsi» désigne un composé d’éléments dont la vocation est de faire du tintamarre et du vacarme» (Le Bikutsi du Cameroun, pp : 15-16). Stanislas Owona parle de «danse frappe-sol». Cette collusion de genres trouverait son explication aux sources de leurs origines. Anthropologiquement, les rythmes qui constituent le socle premier du bikutsi comme du makossa sont, pour une large part, porteurs de fonctions sociales. A l’origine, leur énonciation s’effectue dans des contextes particuliers. De ce point de vue, certains rythmes avaient des vertus cathartiques, nécessitant la mobilisation des dimensions psychosomatiques de l’individu et de sa communauté.

Quant au Makossa, dans son ouvrage éponyme, Noah signale qu’il «est génétiquement une danse» (P.23). S’inspirant du travail de Remy Minko Mba, il remonte la filiation sémantique de ce rythme, où l’on découvre que «le terme Makossa dérive de ‘’m’a kossa’’ qui veut dire littéralement en langue duala et au pluriel les contorsions ; au singulier ‘’di kossa’’ la contorsion». (23) Cette valeur ajoutée épistémique qui se dégage du travail de Noah constitue les premiers éléments d’édification de l’ADN des musiques du Cameroun. Autrement dit, l’ensemble des éléments constitutifs de l’identité de ces musiques. Si le bikutsi est défini de par le son balafon, exécuté soit au balafon, soit à la guitare solo, le makossa est, quant à lui, porté par une prépondérance de la guitare rythmique jouée en arpège et par une syntaxe chorégraphique particulière. Ici, «on danse en se tenant jusqu’au moment ou la mélodie de début s’arrête pour passer à la danse individuelle. Tout le corps bouge de la tête aux pieds en passant par les bras. Les mouvements du corps épousent le tempo. Les contorsions du bassin se déploient avec pudeur et élégance.» (p.55)
Musique camerounaise : comprendre les crises actuelles et tresser des perspectives
Le travail de Noah, met aussi en évidence un certain déclin observé chez ces deux rythmes majeurs de la musique camerounaise. Si l’on peut reprocher au bikutsi d’avoir perdu son exigence au plan orchestral, acoustique et chorégraphie, le makossa, quant à lui, pêche par excès (voir accès) de diversité, ce que l’auteur qualifie de «rationalité de pute», autrement dit, une ouverture à outrance à d’autres sonorités, au point de saborder sa propre identité. De sorte que le makossa par exemple est devenu un appendice d’autres rythmes en vogue comme le coupé-décalé, le mapouka ou le ndombolo. Il convient cependant d’indiquer, pour s’en étonner, que malgré ce déclin constaté des rythmes camerounais, émergent de bons instrumentalistes camerounais, notamment les bassistes : Manfred Long, Vicky Edimo, Jean-Dikoto Mandenguè, Etienne Mbappè, André Manga, Apolo Bass, Atebass, Armand Sabal Lecco, Richard Bona, Guy Nsanguè Akwa, Hilaire Penda, etc. Du fait de ce marasme, nombre d’artistes sont obligés d’aller mettre leurs talents au service d’autres rythmes africains à l’instar d’Edgard Yonkeu en Côte d’ Ivoire, Ribouem au Togo, Roger Kom au Nigéria, Kemayo et Moustick Ambassa au Gabon…
La crise des musiques camerounaises s’appréhende aussi de par la qualité de l’institution musicale camerounaise. Interpellé par un journaliste sur ce sujet, il dira : «La musique camerounaise souffre aujourd’hui d’un déficit de promotion nationale et internationale, d’une vacuité infrastructurelle, d’une sous-estimation des politiques publiques, et d’une absence criarde de financement. Mais, la plus grande menace actuelle est l’absence d’une relève consistante techniquement formée et culturellement enracinée. Les meilleurs du Cameroun ont presque tous dépassé la quarantaine et se sont installés à l’étranger par réalisme professionnel et instinct de survie. La nouvelle génération manque, par phénomène urbain interposé, de feeling et s’est engouffrée faute de structures d’encadrement et de formation adéquate dans la très aseptisée musique assistée par ordinateur». (Le Jour, 09 juillet 2011) A cela, il convient d’ajouter la problématique des droits d’auteur, dont le cafouillis aura causé la mort de nombreux artistes et laissé plein d’autres dans une ténébreuse misère. Face à cette situation, que faire ? «Il faut créer les structures et les infrastructures. Salles de spectacles, conservatoires, écoles de musique, défiscaliser les instruments de musique et subventionner la filière. Cela suppose une intégration plus pertinente et moins folklorique du secteur de la musique dans les politiques publiques.» (Le Jour, 09 juillet 2011).
Joseph Fumtim est éditeur et écrivain. Dernier livre paru Zanzibar Epéme Theodore, la passion Bikutsi, Yaoundé, Ifrikiya, janvier 2013 en collaboration avec Anne Cillon Perri.
Texte publié dans notre édition d’avril 2013 à l’occasion des 40 ans du colloque de Yaoundé sur le Critique africain.